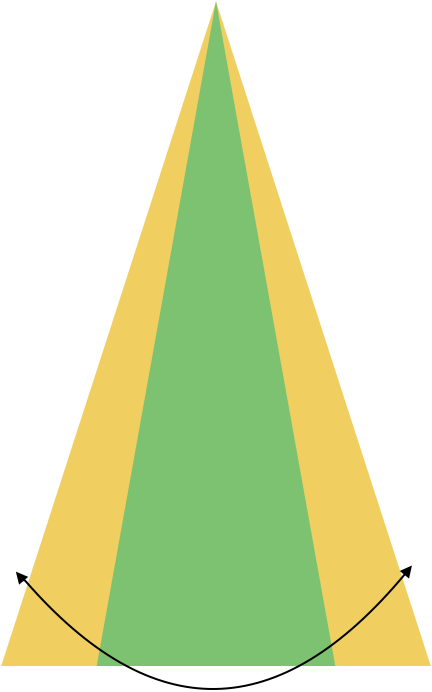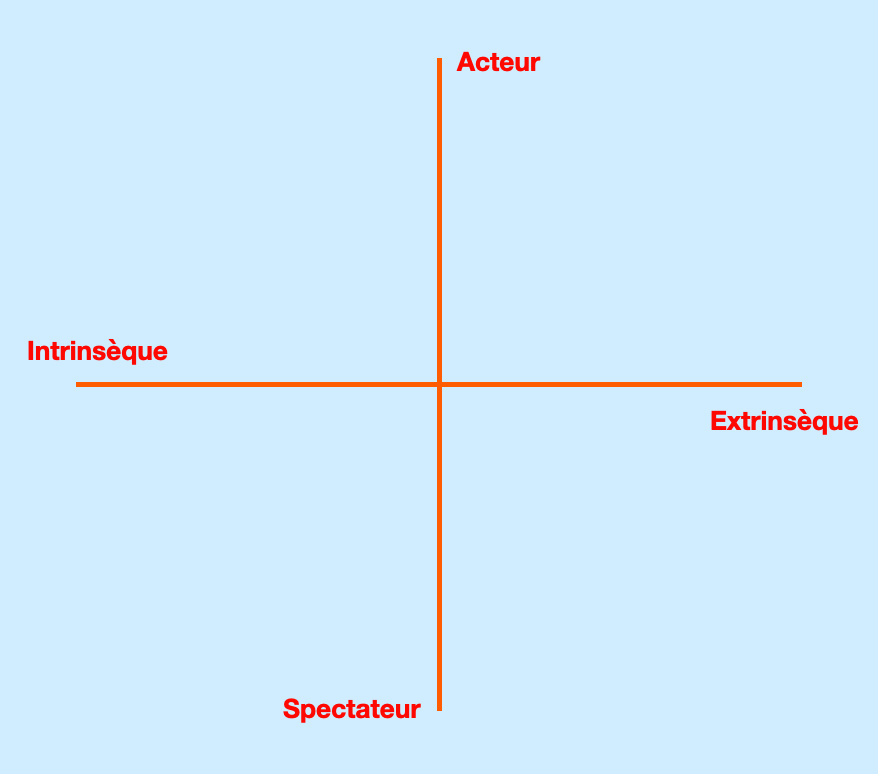En statistique, une simple équation permet de quantifier la récompense minimale à partir de laquelle un pari vaut la peine d’être tenté1 :
Reward * Probability >= Risk
Dans la vie de tous les jours, c’est pas toujours utile. On parie, au sens large du terme, rarement sur des trucs aussi clairs qu’un pile ou face. L’astuce serait alors, pour les situations plus normales de la vie, à inverser l’équation :
Probability >= Risk / Reward
Il suffit alors d’estimer la probabilité minimum à partir de laquelle cela vaut la peine de tenter le coup, et d’utiliser son bon sens pour voir si cela parait raisonnable. Si je prends un simple exemple de location de voiture, imaginons qu’une assurance de 100€ (Risk) permette de diminuer la franchise de 1000€ (Reward). La probabilité d’accident doit donc être d’au moins 10% pour que cela soit un pari “équitable” : probablement pas le cas dans sa ville, possiblement dans un pays qui roule à gauche.
Un (trop) simple outil à garder en poche de temps en temps, que ce soit pour prendre des décisions un tant soit peu, ou en post-rationaliser d’autres, qu’elles furent bonnes ou mauvaises.
- À la roulette, par exemple, miser sur un numéro permet de remporter 36 fois sa mise. Or, le “0” fait que la probabilité est de 1/37. Donc : Probabilité (1/37) < Risk/Reward (1/36). Étonnamment pas un pari bon à prendre… ↩︎